Fanny Lederlin, ex-communicante et doctorante en philosophie, auteure des Dépossédés de l’open space *, nous livre son analyse sur l’impact de la généralisation du télétravail dans les vies des salariés. Elle s’inquiète notamment de ce que cette révolution sociale et sociétale soit, en réalité, abordée essentiellement sous l’angle psychologisant et individuel.
La pandémie a-t-elle changé les modes de travail en France ?
Fanny Lederlin : C’est ce que montrent les chiffres : nous sommes passés de 7 % à 40 % de télétravailleurs. Une grande majorité d’entre eux souhaitent continuer à travailler en mêlant deux à trois jours de télétravail partiel et le reste au bureau. D’après Opinion Way, ils sont même 85 % à vouloir poursuivre ainsi. Mais les modalités restent à inventer.
Ceci implique-t-il une évolution des lieux de travail ?
F. L. : Avant l’essor du télétravail, les employeurs réfléchissaient à rationaliser le coût des bureaux au m2 par travailleur. C’est ce qui a présidé à l’invention de l’open space qui réduit les m2 en cassant les cloisons. Ensuite, il y eut le passage au flex office avec moins de bureaux sur lesquels les salariés tournent.
Chaque transformation a été accompagnée de théories managériales flamboyantes. L’open space devait permettre d’hybrider les compétences, d’amener les gens à travailler davantage ensemble et à mieux communiquer. Grâce au flex office, l’entreprise allait être libérée, agile… Le principe était de casser les cloisons y compris mentales et d’amener les salariés à se réinventer continûment dans la journée.
Aujourd’hui, les employeurs voient un intérêt au télétravail bien qu’ils y étaient d’abord réticents par manque de confiance dans leurs salariés. En réalité, les télétravailleurs sont très efficients, voire plus qu’au bureau. Les employeurs pourront donc poursuivre la rationalisation du coût des bureaux en articulant des flex offices avec le domicile des travailleurs. Les syndicats doivent mener une réflexion pour savoir comment compenser ce prêt que les salariés font à l’employeur en dédiant au travail une partie de l’espace de leur domicile.
Le travail, de moins en moins localisé, envahit la sphère privée…
F. L. : Ouvrir son domicile à son travail crée une indifférenciation entre les temps privés et professionnels. Elle se surajoute à un mouvement plus ancien d’indifférenciation entre le loisir et le travail, sur lequel surfe la nouvelle économie. Le travail digital est pour l’essentiel invisible comme le montre Antonio Casilli dans En attendant les robots**. Il explique que derrière l’intelligence artificielle, les algorithmes… il y a du travail humain caché, du micro-travail, soit peu rémunéré, soit présenté comme un loisir sympathique (par exemple, la mise à contribution du consommateur pour noter un service).
C’est ainsi que le télétravail a pu si bien prendre : nous étions habitués chez nous à passer notre temps sur notre ordinateur. Quand le salarié n’est pas au bureau, il est plus facile de le déranger pour une urgence à 22 heures. Les syndicats doivent se saisir de la question afin d’encadrer les horaires de télétravail plus nettement qu’aujourd’hui.
C’est-à-dire ?
F. L. : Chacun de nous, travailleurs, a tendance à rouvrir son ordinateur après le diner, à travailler dans les cafés… C’est l’effet smartphone, avec la vérification de ses mails à n’importe quelle heure. Il faut s’imposer une séparation entre une vie active et une vie « passive », autre que laborieuse. C’est une discipline à se fixer ! Mais nous sommes déjà très loin dans l’indifférenciation et revenir en arrière risque d’être difficile.
Cette indifférenciation questionne-t-elle le sens au travail ?
F. L. : Parallèlement à ces idéologies du néo-management est apparue une théorie selon laquelle les salariés doivent être engagés à 100 % au travail. L’entreprise ne serait pas juste un lieu professionnel, mais celui d’une adhésion à une grande cause sociétale. Ainsi se sont développés des concepts comme le « purpose », « la raison d’être des entreprises » qui permettaient aux entreprises de se racheter une virginité sociétale ou environnementale.
Ils ont eu pour effet contre-productif d’imposer de l’extérieur, comme une injonction, un sens au travail là où chacun pouvait, par lui-même, donner un sens propre et subjectif à son travail. Les angoisses existentielles autour du travail sont apparues au même moment. Mais les réponses ont été psychologisantes (comment se ressourcer, libérer ses affects…) alors que le sujet est sociétal : le productivisme nuit à l’écologie, le capitalisme a des effets délétères sur le lien social, des effets profonds d’inégalité qui ne cessent de se creuser et qui ont été mis en avant notamment par les travaux de Thomas Piketty ces derniers temps… Ces effets délétères, liés aux modes de production et au modèle économique qui est le nôtre, sont passés sous silence au profit d’une réponse psychologisante et dépolitisante. On réduit donc la question à des problèmes de psychologie individuelle au lieu de l’aborder sous un angle sociétal, collectif et politique.
Signé : Fabien Perrier
* Éditions des Presses universitaires de France, 2020
** Editions du Seuil, collection La Couleur des idées, 2019, avec une postface de Dominique Méda

Fanny Lederlin
Ex-communicante et doctorante en philosophie sur les mutations du travail






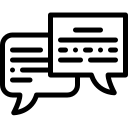
Laisser un commentaire